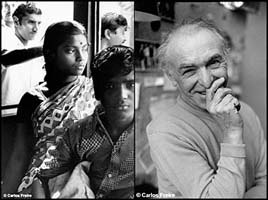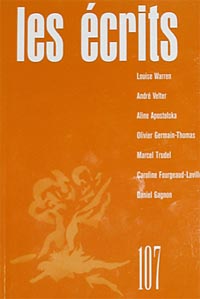Les écrits n°107, Québec, avril 2003
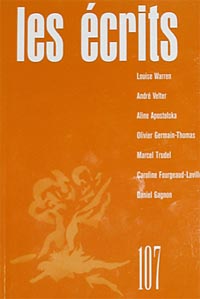
« Parfois se glissent entre deux mots d’usage quotidien, quelques syllabes de langues mortes : mots-spectres qui ont la transparence de la flamme en plein midi, de la lune dans l’azur ».
Pierre Klossowski, Le bain de Diane
Comme nos cœurs, en attente, ou nos mémoires, suspendues dans un intervalle haletant, nos yeux ont soif de reconnaître. La « reconnaissance », si fondatrice en matière d’identité individuelle et affective, exerce également son pouvoir sur nos aventures esthétiques. Enfants et petits-enfants d’écoliers, écoliers à notre tour, nous avons cheminé au travers d’images convoitées-refusées (don d’excellence et prix de fin d’année), d’images offertes (la cartolina des vacances en Italie, celle du Colisée ou de Saint-Pierre de Rome), d’images subies (le sourire hypno-hypothétique de la Joconde), d’images chéries et sublimées (la conquête de l’art classique sur toutes les tablettes de chocolat). Puis les années ont fait le travail, l’accumulation s’est faite en nous, malgré nous, selon la curieuse anarchie de nos goûts et dégoûts, de nos désirs et de nos tabous. Aussi devons-nous à toute une série d’étiquettes, de vignettes, de réduction plastiques plus ou moins heureuses, fac-similés et autres substituts visuels, une part non négligeable de notre pinacothèque personnelle, boîte de Pandore toujours susceptible de s’ouvrir et de libérer – mauvais génie ? – sa miniature autoritaire et castratrice. Nous avons tous le souvenir d’avoir conduit devant l’Opéra de Paris tel ami venu de loin et d’avoir surpris cet aveu qui en dit plus que toute analyse sur les migrations visuelles et l’empire dévastateur des reproductions photographiques : « C’est ressemblant ».
Mais ressemblant à qui, à quoi ? Que voyons-nous face à l’original sinon la reproduction têtue – et coupeuse de têtes – au regard de quoi rien ne mérite d’exister ? Il repose en nous un fantôme culturel glané de-ci de-là au détour d’un album d’enfance ou d’une image de confiseur, conservant le souvenir du sucre et, comme lui, abandonnant la souplesse translucide du sirop pour s’opacifier et se durcir au contact de l’air. Non seulement ces images survivent à tout le remue-ménage grossier ou subtil de nos apprentissages et de nos sensibilités en friches, mais s’interposent comme un écran déformant, paupières secondes, entre l’œil et l’œuvre originale, réduisant l’espace, le bien nommé « champ de vision », où l’air respire de toutes ses circulations possibles. C’est une sorte de peau morte, tantôt voile inhibant tantôt fantôme habité qui nous rappelle, dès que nos regards croisent une petite idole du V° siècle avant Jésus Christ ou un pot de fleurs laqué-or de Raynaud, que quelque chose de morbide se joue entre l’œuvre et nous, que la contemplation accueille la mort et qu’elle a partie liée avec une forme de messe pour le temps présent, célébration commémorative malgré l’actualité du coup d’œil. Dans l’œuvre de musée cohabitent sans contradiction l’idée d’héritage et celle d’actualité. Seul le musée peut occasionner une telle expérience de simultanéité entre passé et présent : visiteurs, nous sommes les insolites héritiers d’une forme à naître, d’une forme réelle certes, mais perpétuellement en attente de mise à vie (comme on parle de mise à mort) sous le détonateur d’un regard. Encore faut-il ménager la flamme.
L’expérience du musée n’est que cela : jouissance de reconnaître. Vient-on au Louvre pour découvrir la Joconde ou pour la retrouver, ressusciter l’image endormie et convoquer son spectre lointainement présent ? Les défilés placides et passifs en période scolaire ou estivale enseignent le degré d’indifférence des visiteurs, certes, indiquant la valeur purement symbolique, mais non moins initiatique, d’une telle déambulation entre des murs balisés, des salles fléchées, le labyrinthe obscur d’une exposition provisoire ponctuée çà et là de quelques feux : nouveaux mystères, nouveaux orants. Chacun agite à la face de l’œuvre « retrouvée » son clone-clownesque comme sur le quai d’une gare le mouchoir des adieux, ou celui, timidement blanc, implorant la fin des hostilités… et en effet le choc du réel vif et présent des œuvres avec celui des hommes, ce double conflit, faiblit, s’apaise, s’épuise et finit par ne plus avoir lieu faute de combattants. Les œuvres crient et nous ne les entendons plus : Vénus de Milo, Joconde, Nymphéas, que seriez-vous si nos imaginaires ne vous avaient pas absorbés, si nos sociétés n’avaient pas fait de vous des icônes culturelles et si nos têtes ne vous avaient pas aménagé en quelque lieu retiré du cerveau sensible une chambre de repos ? chambre froide aussi bien ? Les œuvres sont doublement prisonnières : mises en cage dans l’orbite de nos visions savamment averties, prises au piège du musée sous étroite surveillance du gardien. Mais ce geôlier aux clefs entrechoquées dans un inquiétant couloir de poussières et d’ombres, que garde-t-il au juste ?
Aux heures ouvrables nos cages mentales libèrent leurs images et le gardien dépose ses clefs. L’œuvre de musée devient pur accessoire, pierre de touche, principe de réalité auprès duquel vient se mesurer son double insubstantiel. La pâle copie abolit et place comme secondaire l’œuvre originale en un renversement identitaire qui ne peut être sans grandes conséquences. Car nos souvenirs ne viennent pas puiser à une source première mais plutôt faire la rencontre d’un fantôme muet. Peut-être avons-nous fait trop crédit à la notion de « connaissance » : tant que connaître signifiera pour nous une indigente relation aux références, nous serons à jamais orphelins de la matrice originelle de l’art. Nous n’aurons pas la naïveté de croire à une vision délestée d’idées mais il faudrait du moins tendre vers une certaine forme d’inconnaissance. Car le véritable parasite de l’œil n’est pas la culture avec son ballet incessant d’objets, de paroles et de paysages traversés, mais bien plutôt l’univers des références et leurs rigidités qui renvoient comme un boomerang l’œuvre à elle-même. C’est que, armés de références, nous ne venons pas associer à la Joconde une image ou une idée qui lui soient extérieures et qui contribueraient à enrichir la vision, nous venons au contraire ajouter à la Joconde le fantôme de la Joconde ; l’œuvre est alors vécue dans une autoréférence qui enraille le processus de renouvellement de la perception. La vision se mord la queue sans aller se rafraîchir à d’autres sources : il n’y a plus d’arrière-monde qui flambe derrière la touche d’huile. Nous devrions abolir l’univers des références et ouvrir grandes nos portes à la culture, de sorte qu’en voyant la Joconde nous ferions la rencontre d’un fantôme bien sûr, mais d’un fantôme hanté par notre propre regard, d’un fantôme « habité » si j’ose dire. L’autoréférence est le péril et la marque de fabrique de notre société en ses modes de penser et de produire. Songeons à la vague pauvrement déferlante, en littérature, de l’autofiction où l’œuvre est d’abord l’œuvre d’un auteur, et n’est que cela. Quand l’art s’est efforcé d’atteindre une autonomie et une certaine ontologie, nous assistons impuissants à une régression par dissolution de ce qui distinguait les deux êtres, celui de l’œuvre et celui de l’auteur. La confusion est à nouveau instituée : nous sommes sous le règne de l’autoréférence. Aujourd’hui le moi de l’auteur assiège celui de l’œuvre. Peut-être sommes-nous les enfants-victimes du Ready-made et de l’Intention comme critère nécessaire et suffisant. L’œuvre de musée étranglée entre les références des visiteurs et celles des auteurs attend de renaître. Il est pourtant des œuvres qui vivent toutes seules, d’elles-mêmes : la Joconde se passe de Leonard tandis que la roue de bicyclette ou l’urinoir ne peuvent se passer de Marcel Duchamp. Après l’expérience de dépossession vécue conjointement par Mallarmé et Cézanne, nous assistons à un recul de l’artifice et de l’abstraction. L’autoréférence de l’œuvre à son auteur induit une nouvelle forme de comportement : nos yeux se sont habitués à voir double, à contempler simultanément un nom et une œuvre, à « reconnaître » un Picasso. Ainsi, plus grave que la présence de fantômes stériles, est l’absence de fantômes : les fantômes disparaissent, s’évanouissent derrière les cimaises, ou pire, finissent par s’incarner.
Deux circulations telles deux veines jugulaires, parallèles et contraires traversent le musée. La première, brûlant les étapes de la relation au spectre, passant du souvenir au fantôme et aboutissant à son succédané par l’achat du catalogue, livre d’images s’il en est, lui-même gros de tous les fantômes à venir. Produits dérivés dit-on, et en effet tout est dans la dérivation. Hasard d’une promenade ? entrer dans un musée par sa librairie (terme trompeur désignant un chaland de bricoles quincaillières, où le souvenir est monnayable : le bijou de l’Olympia au poignet d’une demoiselle…) l’œuvre de musée étend ainsi sa présence en nous à grand renfort de politique et de marketing culturels. Mais ces états de présence multiplient en l’absentant de plus en plus l’idée de l’art. La seconde veine, la plus dense, celle que nous devrions tous emprunter, fait dialoguer les différentes strates d’invisibilité qui constituent l’image du spectre contemplé, enrichissant ce que Malraux appelait le musée personnel de chacun. Duel inégal de la Culture contre la Référence. Bibliothèque idéale, musée imaginaire : deux fantasmes de la politique culturelle française des années 60 devenus aujourd’hui deux catégories de l’imaginaire des « citoyens de la culture » que nous sommes. Le comble étant atteint avec le phénomène des fondations et autres collections privées aux architectures puissantes, Guggenheim entre autres, couvrant nominalement les œuvres en les mettant en boîte : boîte à chapeau du Guggenheim, boîte de chocolats, formant enseigne, colimaçon symbolique aux allures de chaîne commerciale, super-espace de l’art, label rouge du goût et de ses preuves. Le flâneur de Venise ou celui de New York a l’assurance de retrouver un Picasso, un Matisse et un Cézanne dans « son » Guggenheim, et les noms propres deviennent des noms communs, des produits-repères, fichant des amers dans ce qui aurait dû n’être qu’un océan ravagé d’inconnu et de rencontres fortuites. Les œuvres d’art prises comme telles dans ces maisons de la culture que sont les musées ou les fondations redeviennent des objets. Ce que nous avons mis tant de générations à reconnaître non comme de simples objets, mais comme ces « êtres non naturels » dont parlait Lévinas, sont collectionnés, épinglés, étiquetés, crucifiés parfois, et le voisinage étroit de leurs congénères épuise leur réserve de vie pour, dans cette population muette des œuvres de musée, n’être plus que des formes les unes soutenant les autres, l’une adossée à la matière de l’autre. Musée des arts premiers : écorce contre écorce, bois sculpté contre terre cuite, va-et-vient perplexe du regard de l’ethnologue à celui de l’esthète.
Oublions le mobilier et revenons à la maison, cette vaste maison invisible qu’est le musée, refuge précieux de nos cultures sur la surface urbanisée du globe. L’œuvre de musée permet ainsi, à son tour, les « retrouvailles ». Quelles que soient les latitudes et les longitudes, il arrive presque toujours qu’un musée nous fasse signe et que, soudain, ce soit l’œuvre de musée qui en vienne à nous retrouver. On est partout chez soi dans un musée clame l’internationale muséologique : New York, Londres, Saint-Pétersbourg forment une chaîne cohérente mais pacifiante, nivelant les références et les goûts. Chaque capitale réclame son musée comme son espace personnel de quête de la reconnaissance. Quel beau rêve, et quel leurre, ce désir d’une communauté d’origine qu’entretient le concept utopiste de musée archéologique : « les Grecs, c’est nous » pensent toutes les capitales de la culture mondiale. Quand, légèrement étourdie de musique orientale et d’architecture ottomane, je pousse la lourde porte du musée archéologique d’Istanbul, mon cœur s’apaise, mon souffle reprend sa cadence habituelle : je suis chez moi, une lampe à huile, un rhyton, une cariatide et le tour est joué ? le paradis perdu à portée de regard.
On nous fera remarquer que Malraux formulait avec son musée imaginaire un idéal irréalisable : l’intrusion des œuvres d’art dans la cosa mentale de chacun. Or c’est le contraire qui s’est produit, ce n’est pas l’imaginaire qui s’est constitué un musée mais le musée qui s’est édifié en lieu imaginaire où les hommes dialoguent avec des fantômes. Le musée imaginaire est devenu la chose du monde la mieux partagée, une agora fictive ou s’échangent des idées de l’art : il n’est plus que de rapport de virtualité à virtualité dans nos musées.Il faudrait savoir oublier, laisser les voiles au vestiaire et contempler un visage, fût-il non naturel, un visage tout de même, une identité neuve. Il faudrait pouvoir encore dire « tu » à l’œuvre d’art.
Livrons à l’œil ses fantômes et laissons les voiles traverser toutes les salles de tous les musées du monde, il tient seulement à nous que le voile étouffe ou qu’il étoffe le regard. Ces fantômes qui peuplent le fond de l’œil de chacun, c’est ce que certains nomment à tort la culture, d’autres l’éducation mais qui peuvent, à terme, nourrir le glaucome esthétique qui s’étend et projette son ombre sur nos sensibilités. C’est ainsi que de fantôme en fantôme, par cumulation du voile sur la rétine intérieure, l’individu devient lui-même pure abstraction. Sauvons nos fantômes de leurs voiles, et que la flamme ou la lune éclairent d’un rayon fort nos prochaines visions !