08 octobre – 04 novembre 2007 – Musée Bénaki – Athènes
« Fluxus, c’est gratuit »
Commissariat d’exposition :
Ben Vautier : Artiste
Caroline Fourgeaud-Laville : Attachée culturelle
Nicolas Feuillie : Auteur de Fluxus dixit, Presses du réel, 2002.

PRESENTATION DE L’EXPOSITION
« Fluxus, c’est gratuit » est une exposition, certes, mais plus encore un événement. Cet événement c’est le Centenaire de l’Institut Français d’Athènes.
Il est peu de pays dans le monde qui puisse se féliciter d’avoir nourri une telle relation sur de si longues années. Or la France et la Grèce sont de ces frères de route que les difficultés rendent toujours plus solidaires. L’Institut, les Athéniens le savent bien, a traversé avec bravoure les tumultes de l’Histoire et fut pour beaucoup d’intellectuels, d’artistes et d’étudiants, un refuge dans les heures pénibles. Voilà pourquoi nous avons souhaité associer à cette célébration, Fluxus, mouvement issu des contestations des années 60, transgressif, souvent révolutionnaire, résistant, à sa manière, contre toutes les formes d’oppression.
Le mouvement Fluxus, comme le révèle sa racine latine flux, circula comme un torrent en faisant grand bruit au passage des obstacles. En Europe comme en Amérique, et dès les années 70 en Grèce, il suscita de vivifiants mélanges entre les arts : musique, théâtre, arts plastiques, littérature, architecture… faisant sauter les clivages, renonçant aux étiquetages rapides et arbitraires, revendiquant la liberté dans l’union : vaste programme qui devait trouver de nombreux émules en Grèce ! Citons les musiciens Grigoris Semitokolos et Giannis Christou qui donnèrent une impulsion nouvelle au dialogue entre les arts, à leur démocratisation et enfin à l’implication du public au travers de happenings et d’installations plastiques. Peintres, poètes, scientifiques, compositeurs se retrouvèrent également autour de Yannis Xenakis et de Stephanos Vasiliadis dans le cadre du Centre de Création de Musique Contemporaine créé en 1985.
On assiste aujourd’hui encore à une véritable résurgence de Fluxus : art video, art cinétique, art optico-cinétique, art numérique, Net.art, mail art ont tous puisé leur source auprès de ces merveilleux « ancêtres » des années 60. Dans cette évolution Fluxus a joué en effet un rôle déterminant. Dick Higgins, un artiste et écrivain du mouvement, amena le terme d’ « intermedia » pour parler de pratiques artistiques se situant entre les supports traditionnels. Explorant en effet les interstices entre l’art et la vie, Fluxus s’est installé entre musique et art, entre théâtre et vie, entre artisanat et industrie, entre objet unique et multiple : il y a des timbres Fluxus, des tampons, des dés, des vêtements, il y a eu une messe Fluxus, une coopérative, des projets pour l’établissement d’une île Fluxus (dans les Cyclades peut-être ?)… De Fluxus, mouvement international, parlant toutes les langues, sont issus Nam June Paik, inventeur de l’art vidéo, Robert Filliou, créateur de la « République géniale », du principe d’équivalence entre « Bien fait, mal fait et pas fait », Joseph Beuys déclarant « tout homme est un artiste », Ben enfin, investissant sans relâche tous les supports en quête d’apports artistiques inédits.
Remettant radicalement en cause l’art, Fluxus l’a par là même radicalement renouvelé, livrant toujours son combat avec humour et un très grand sens de la dérision. L’art contemporain est une fête, Fluxus le prouve à chaque fois. Des années 70 à nos jours le flux de ce mouvement provocateur à traversé tous les arts et inspiré la France comme la Grèce, revendiquant le droit à la « gratuité » dans un monde dominé par les échanges économiques. Préférant de loin troquer des devises contre des aphorismes, ces artistes avant-gardistes, sont de lumineux apôtres d’une église sans chapelle, d’un mouvement sans maître.
L’Institut Français d’Athènes a donc choisi l’art contemporain pour fêter ses 100 ans au Musée Bénaki. Car, au-delà des commémorations nécessaires il appartient d’inscrire l’histoire prestigieuse de l’Institut dans de grandes manifestations artistiques portées par des artistes d’aujourd’hui. « Rendre l’art accessible à tous en le rapprochant » n’est pas seulement la formule sacrée de ce mouvement populaire et généreux, c’est aussi un principe que nous adoptons volontiers dans notre travail au quotidien, à l’Institut, et que nous faisons nôtre ici tout particulièrement.
Caroline Fourgeaud-Laville
VISITE DES SALLES
SALLE 1
1. Manifeste Fluxus de Maciunas : écrit en 1966, texte fondamental du mouvement exposant tout ce qui différencie Fluxus du « grand » art. le problème de Fluxus c’est que ce n’est pas un mouvement constitué. Personne n’a jamais signé de manifeste. Celui-ci a été signé par Maciunas et n’engage que lui. Fluxus n’existe pas en 58, il ne naît vraiment qu’à partir de 62 avec la série de concerts Fluxus qui voient le jour en Allemagne, et se poursuivent en Europe. Avant cela Maciunas qui vivait à New York, rencontra Yoko Ono et La Monte Young qui l’initièrent au monde de l’avant-garde ; comme il possédait une galerie, la galerie « AG », il offrit à La Monte Young la possibilité d’organiser des soirées où l’on pouvait assister à de la musique-action, de la musique électronique, du cinéma, de la poésie… Ces soirées faisaient suite à celles que Yoko Ono avaient organisées dans son propre atelier peu auparavant. Ces soirées faisaient une large place à l’avant-garde artistique, ouvertes à toutes les expressions, de la musique vers l’action, la poésie, de la poésie vers la musique, vers le théâtre, etc. Le hasard, la participation éventuelle du public, l’improvisation, l’environnement quotidien (gestes, objets…) jouaient aussi leur rôle, et l’idée même d’abolition des frontières artistiques était très importante… Lorsqu’un éditeur californien proposa à La Monte Young de préparer un numéro spécial sur le bouillonnement artistique des années 60, celui-ci s’acquitta de sa tâche ; mais le projet fut abandonné, Maciunas reprit alors le matériel pour réaliser une anthologie Fluxus avant l’heure, intitulée tout simplement « An Anthology », brochure qui marque le début de l’engagement de Maciunas dans ce qui allait devenir « Fluxus ». Après 61, Maciunas étant criblé de dettes (les derniers concerts Fluxus organisés chez lui se font sans électricité), il décide de quitter les Etats-Unis pour l’Allemagne, où Nam June Paik se propose de le recevoir. Maciunas y travaillera comme graphiste d’un journal de l’armée américaine. Il rencontre beaucoup d’artistes : Nam June Paik, Ben Patterson, Vostell, Stockhausen qui organisent des cours et des conférences. Stockhausen est un homme rigoureux et difficile alors que Cage est très ouvert, « zen », il inspirera davantage les membres de Fluxus. C’est ici que commencent les concerts de Wiesbaden. Maciunas obtient en effet une salle du musée de Wiesbaden pour jouer pendant un mois tous les week-end des concerts Fluxus. Puis ces concerts s’exportèrent à Paris, Londres, Amsterdam, Copenhague, Düsseldorf, enfin à Nice où Ben accueillera le Festival Fluxus en 1963. Lors de ces concerts, il y avait des pièces de tous les artistes, de nature très différentes. Il y en avait de très longues qui pouvaient durer des heures, et de très courtes, moins d’une minute. Or Maciunas a principalement souhaité valoriser les pièces courtes de quelques minutes, plus accessibles au public, en les orientant vers plus de drôlerie et de comique. C’est une vision qui peut paraître, aux yeux de certains, quelque peu réductrice de l’esprit Fluxus, mais c’est elle qui aujourd’hui encore est défendue par Ben, elle est aussi la plus populaire. Ben préfère le court et le drôle parce qu’il en connaît très bien les vertus pédagogiques.. En 1964 le groupe a éclaté. Maciunas voulait tout diriger d’une main de fer, rêvant de piloter un collectif d’artistes, il proposa que chaque artiste abandonne sa signature, son copyright, pour venir s’abriter derrière le seul sigle de Fluxus. Or très vite les personnalités les plus fortes et les plus abouties ont préféré voler de leurs propres ailes : Nam Jun Paik, Dick Higgins sont les premiers à trahir cet idéologie. Maciunas était en effet très marqué par Henry Flynt, mathématicien, philosophe et artiste Fluxus, mobilisé par la pensée communiste et qui voulait l’appliquer à l’art. Sous son influence, Maciunas voulait donner un tournant révolutionnaire à Fluxus, provoquer des manifestations violentes, et monter des concerts Fluxus en URSS, le long du transsibérien. Il va même jusqu’à écrire Khroutchev en ce sens. C’est à ce moment-là que les artistes ont commencé à s’éloigner. Maciunas a réagi en publiant, d’une manière obsessionnelle, des listes arborescentes d’adhérents sans demander par ailleurs leur avis aux artistes cités ! Certains se trouvaient alors inscrits dans Fluxus, ce fut le cas de Ligeti, ou se retrouvaient exclus sans en être informés. Maciunas ajoutait ou retranchait des noms compulsivement dans le simple but de s’ériger comme leader d’un immense groupe aux membres toujours plus prestigieux ! En 1963 Maciunas revient à New York et décide d’asseoir Fluxus en créant une structure sur Canal Street : le Fluxus Hall et le Fluxus Shop. Il fait jouer Dick Higgins, Alison Knowles, Emmett Williams et George Brecht. Ben vient passer un mois à New York car les deux hommes avaient sympathisé : c’est d’ailleurs curieux, parce qu’il ne faut pas oublier que l’ego était proscrit par l’idéologue Maciunas, un ego dont Ben a fait sa marque. cela prouve combien Fluxus a toujours été pétri de contradictions. En 1964 Yoko Ono rentre au Japon, Paik s’y installe aussi. Higgins quitte aussi le groupe. La Monte Young poursuit son chemin vers la musique minimale. Malgré l’éclatement du mouvement, l’on peut donner un bilan positif de ces quelques années fondatrices car beaucoup de pratiques de l’art contemporain ont été inventées par ces artistes : art vidéo, art conceptuel, body art, livre d’artiste, boîte d’artiste… Fluxus a mis sa patte dans la plupart des nouvelles pratiques de l’art contemporain. Même l’art relationnel dont on parle aujourd’hui (prendre le thé ensemble), procède des idées Fluxus. Après 1964 Fluxus a surtout existé à travers la production de petites boîtes éditées par les artistes, par la création d’objets, plus que par la musique. Maciunas aimait le concret. La production d’objets Fluxus utilisait des produits industriels (boîtes en plastique…), mais elle était le plus souvent totalement artisanale. C’est Maciunas aidé quelquefois d’autres artistes qui fabriquait tout à la main. Fluxus s’est poursuivi au moins jusqu’à la mort de Maciunas en 1978. C’est ainsi que Maciunas a contribué à la naissance du quartier des artistes qu’est SoHo, qui était jusqu’alors un quartier de petite industrie, en permettant à de nombreux artistes d’y installer des ateliers, et il ne fut jamais en manque de grandes idées pour Fluxus : il organisa une messe Fluxus, un mariage Fluxus (le sien), projeta de créer des communautés d’artistes, une dans une ferme à la campagne, une sur une île qu’il voulait acquérir au cœur de l’archipel des îles Vierges britanniques.
2.
Eric Andersen « Performance area, do not enter » : l’impossible performance ! Musicien et compositeur, c’est en 1962 qu’il adhère à Fluxus lors du concert de Copenhague. Andersen explore avec humour ces espaces de liberté qui nous sont toujours refusés. C’est aussi sans doute la preuve que pour Fluxus un geste minimal confinant au non geste, à l’absence de manifestation est encore une performance : il peut ne rien se produire dans la zone de performance, son accès peut vous être refusé, c’est encore une performance. Ne pas entrer sacralise le lieu de cette action qui n’existe pas. Cela rejoint Cage et sa musique de silence
3.
Robin Page. Comme souvent, pas mal de personnes n’ont fait que passer dans le mouvement le temps d’un concert. C’est le cas de Robin Page qui a participé au concert de 1962 à Londres, au Festival of Misfits, où il s’était illustré en cassant une guitare. Il s’agit ici du reste sans doute d’une de ses performances érigée en œuvre d’art. Son titre de gloire est d’avoir cassé une guitare sur scène avant Jimmy Hendrix.
4.
Robert Filliou et son principe d’équivalence “bien fait, mal fait, pas fait”. Son oeuvre s’inscrit quant à elle délibérément dans le “mal fait” d’où l’utilisation du scotch. Il interroge l’origine de l’art par la génétique, l’archéologie, les planètes, en montrant que l’art se rattache à la création du monde. Il donna un jour une série de papiers déchirés dans un musée allemand pour une expo et il retrouva ses papiers reconstitués par les restaurateurs du musée : c’est l’œuvre qui est affichée ici. Il dénonce la sacralisation de l’art qui pousse les spécialistes à recueillir le moindre fragment d’une œuvre passée et à considérer, par excessive métonymie, qu’elle puisse être exposée comme un tout. Pour Filliou la poussière recueillie sur un tableau de Leonard n’est pas un Leonard ! Il faut en finir avec cette fétichisation extrême de l’œuvre et du nom qui lui est attaché.
5.
Giuseppe Chiari. La plupart des artistes Fluxus sont au départ musiciens, c’est le cas de Chiari. Beaucoup de Fluxus se sont retrouvés en Allemagne à une époque, au Festival de Darmstadt dans les années 50, où de nombreux musiciens d’avant-garde jouaient des pièces : Stockhausen, Cage… Dans un mouvement d’inversion les musiciens Fluxus prouvaient que tout pouvait faire musique en détournant notamment les instruments, en pervertissant les codes sacrés du concert classique. Ligeti lui-même avait créé une pièce pour métronomes : ce qui n’est qu’une utilité mais qui dirige autoritairement le rythme du jeu, un métronome, devient tout à coup la pièce exécutante, comme si le musicien avait repris le contrôle du concert, repris le pouvoir sur la règle castratrice. Beaucoup d’artistes Fluxus ont créé des slogans, celui de Chiari est “Art is easy”.
6.
Serge III (frère de Zoé Oldenbourg). Russe de Nice. Artiste radical. Il a joué à la roulette russe sur scène avec un vrai pistolet chargé. Lors d’un voyage à Prague avec Ben, ils ont voulu faire passer quelqu’un de l’autre côté de la frontière sans passeport. Serge III s’est fait arrêté et a dû faire un peu plus d’un an de prison en Tchécoslovaquie (66-67). Il s’est toujours vraiment engagé. Après sa sortie de prison il s’est mis à travailler sur les affiches de pubs ou de cinéma, en en détournant les codes.
7.
Wolf Vostell. Graphiste au départ. Il est à la limite de Fluxus. Il a commencé par décoller des affiches comme les artistes du Nouveau Réalisme, mais il a très vite étendu le principe de décollage au happening, en considérant que le corps lui-même en action était dans une action de décollage extrême, par la violence et la destruction. Il s’emploie à dévoiler la violence latente d’une société apparemment lisse. En 1960, à Paris, il avait lu dans les journaux qu’un avion s’était abîmé en mer après son décollage. Pour lui c’est le moment où la réalité dépasse la fiction, le moment où la violence surgit dans la réalité sans qu’on s’y attende. Les membres du groupes lui reprochaient son manque de modestie qui, doctrinairement, devrait l’éloigner de Fluxus. Maciunas, le pape de Fluxus, s’opposait à lui fréquemment sur ce point. Vostell était très dynamique, très inventif, il avait créé sa propre revue “décollage”, or Maciunas était moins habile que lui ! Vostell a participé aux concerts des années 62 et 63, et créé un musée Fluxus en Espagne, à Malpartida. En tant qu’Allemand son œuvre montre à quel point il est hanté par le passé nazi et la violence.
8.
Joseph Beuys. D’une certaine manière il est encore plus « limite » que Vostell. Il s’est imposé alors que son œuvre n’a pas grand chose à voir avec le groupe. Il est très expressionniste, il s’est créé sa propre mythologie, celle d’un aviateur allemand dont l’avion se serait écrasé pendant la seconde guerre mondiale en pleine Asie Centrale. Il prétend à partir de là avoir été secouru par des chamans et ramené par eux à la vie. Fourrure, graisse, sont ses matières fétiches, de même que l’énergie est son principal sujet : chaleur, feu…
9.
Ben Patterson. Au départ c’est un vrai musicien, un concertiste qui a joué dans de prestigieux orchestres, un virtuose de la contrebasse. Il vit aux Etats-Unis et il lui est interdit, parce qu’il est noir, de jouer dans des orchestres symphoniques. Il quitte donc les Etats-Unis pour s’installer au Canada où il deviendra concertiste pour le philharmonique d’Ottawa. Puis il part en Allemagne où il entre à l’orchestre de la 7ème armée américaine. Il souhaite très vite rencontrer Stockhausen à Cologne. La rencontre est décevante. Cage au contraire le bouleverse et il décide alors de composer lui-même des pièces. Il restera un certain temps en Allemagne. Il publie un ouvrage de ses compositions aujourd’hui introuvable (dont « paper piece » qui fut interprétée le soir du vernissage). En 1962 Il part à Paris et rencontre Filliou qui lui mettra une œuvre dans son chapeau ! Il a voulu faire une œuvre basée sur l’action avec une participation du public. Selon lui il faut hisser la musique jusqu’à la vie. La dimension comique de ses interprétations n’empêche pas l’ambition de son projet. Il a fait ainsi de « l’action » jusqu’en 63 puis il est rentré aux Etats-Unis. A l’époque la révolte des Blacks Panthers battait son plein, il a donc choisi de s’engager politiquement jusqu’en 80 où il recommence une pratique libre et personnelle de l’art et de la musique, en intégrant des revendications. Interrogations : peut-on parler de « culture noble » et de « culture pas noble », de grande ou de petite culture ?
10.
George Brecht. (table et boîte avec vignettes) Il est l’un des membres les plus importants du groupe, plus que Maciunas qui ne fut au fond qu’un « organisateur », un meneur. Il est chimiste au départ, et a même produit des brevets, a travaillé dans des laboratoires pharmaceutiques. Il s’est intéressé au hasard dans l’art en étudiant l’aléatoire chez Jackson Pollock, puis il a rencontré Cage et a suivi ses cours. Aux côtés de Cage il a approfondi la notion de hasard en art en la reliant à la physique des particules : le hasard est au cœur de la matière et tout s’organise autour de son incidence. Un jour il est rentré chez lui et s’est aperçu que le clignotant de sa voiture marchait tout seul, il a trouvé ça très beau et ce fut ce qu’il a baptisé ensuite « event ». il a donc composé de petites cartes avec des events à réaliser, même mentalement . Un event peut être infiniment simple : placer deux chaises face à face ; ou plus complexe : vous allez en voiture chez le garagiste, vous faites gonfler votre pneu jusqu’à ce qu’il éclate puis vous rentrez chez vous. En un mot, il s’agit vraiment d’appliquer les idées sans engager son ego. Avec Robert Filliou ce sont les plus stimulants du groupes, ce sont de véritables concepteurs. Brecht a mis ses « events » en boîtes : les « boîtes magiques de Brecht ». La réduction d’une idée ou d’une œuvre à une boîte, ou à une petite carte, est un classique du groupe qui pratique l’art du minimalisme avec une certaine science. Le rôle des petits objets dans l’expression du mouvement est capital. En 1962 il avait créé son Festival à New York « Yam » au mois de mai (anagramme). Il est le vrai cerveau du groupe et le détenteur incontesté de l’esprit Fluxus : anonymat , faire en sorte qu’un objet banal soit transformé en œuvre puis revienne dans le domaine de la vie sans qu’on puisse après coup déterminer son statut.
11.
Filliou. (vitrine centre) Il appartient à une lignée d’artistes qui, de Marcel Duchamp à Joseph Beuys et de Kurt Schwitters à John Cage, remet en cause les relations traditionnelles de l’art et du monde : « C’en est fini pour moi des objets-œuvres d’art. Ils ne sont plus pour moi que des pistes de décollage. » L’œuvre de Robert Filliou reste, de part en part, obsédée par l’idée de paix. En 1970, il réalise Commemor, proposant « aux pays qui songeraient à faire la guerre d’échanger leurs monuments aux morts avant et au lieu de se la faire ».Dans cette perspective, il a fondé « The Afro-Asiatic Combine » (dédié à la recherche sur l’influence de la pensée contemporaine africaine et asiatique sur la culture occidentale), la Biennale d’art de la paix à Hambourg et il a imaginé l’année des « 365 premiers avril » (1971). Au travers de ses images, mots, objets, actions, installations et autres « briquolages », Filliou envisage l’œuvre comme une langue universelle dont l’utopie consiste à abolir les frontières entre l’art et la vie. « L’art, remarque le créateur de la « République Géniale », est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. ». Il a participé à Fluxus pour la première fois en 1962, à Paris, avec Maciunas. Dans l’une des vitrines on voit un chapeau découpé : c’est une galerie d’art dans un chapeau ! Il jetait des photos d’œuvres d’art de tous ses amis dans le chapeau, de sorte qu’il devienne un « couvre chefs-d’œuvre ». A l’instar de ce qui est exposé ici, de nombreuse œuvres de Fluxus sont créées puis répétées à un petit nombre d’exemplaires, car les membres de Fluxus jouent sur la notion de reproductibilité de l’œuvre sans aucun complexe.
12.
Serge III. Il a fait des verres en négatifs (vitrine) mais aussi des armoires en négatif : il coulait du ciment dans une armoire puis il détruisait l’armoire pour libérer la forme pleine.
13.
Charles Dreyfus, joue sur les mots. Ses œuvres portent, gravées à l’or fin sur des objets utilitaires très communs, des formules à clefs, à déchiffrer comme des énigmes en forme de calembours. Il est le premier Français à avoir fait un travail universitaire sur Fluxus puis il a, en 1974, organisé une petite exposition au Musée d’art Moderne de la ville de Paris. Enfin il est allé à New York où il a rencontré Maciunas et les autres artistes Fluxus. Depuis il mène la double activité de critique et d’artiste.
14. Maciunas (mur de droite en entrant) Il peut être considéré comme le pape du mouvement. Il était graphiste. Il avait instauré la règle du 8-8-8 car il exigeait une discipline de chacun des membres du groupe : dans une journée on devait travailler 8 heures, dormir 8 heures et le reste du temps devait être consacré à une activité Fluxus. En tant que graphiste il a édité des journaux Fluxus qui ne se sont jamais vendus, il les composait en faisant des montages de documents qu’il trouvait à la bibliothèque de New York et qu’il détournait. Il a ouvert un magasin fluxus (Fluxus shop) et une salle de spectacle Fluxus, mais les affaires ont toujours très mal tourné. Il s’est mis à utiliser les œuvres des autres et à les réduire en boîte : La Monte Young avait inventé une pièce qui consistait à faire du feu en public. Maciunas a mis des allumettes dans une de ses boîtes en plastique et a collé dessus l’étiquette suivante : « pièce de La Monte Young » qu’il vendait dans son magasin de Canal Street à New York (c’est un exemple de la fameuse circulation des œuvres dans le groupe).
15.
Ben signe tout et c’est ainsi qu’il se réapproprie le monde, en le phagocytant…
16.
Horloge de Charles Dreyfus : le temps s’affole !
17.
Portrait de John Cage (mur de droite avant d’entrer dans la deuxième salle) On peut dire que Fluxus a commencé en Allemagne à la fin des années 50, autour de Darmstadt, puis le mouvement a émigré aux Etats-Unis en 60, la création du quartier de Soho n’en est que la plus vive expression. On peut également dire que l’acte de naissance du mouvement est largement entre les mains de John Cage et sur ses partitions alors même qu’il se tiendra toujours à l’écart du groupe, Maciunas assumant seul la tâche de dictateur. Cage disait que ce qu’il préférait dans un concert c’était le moment où les musiciens accordaient leurs instruments car alors le public n’était qu’attentif aux sons pas aux geste où à la mise en scène du concert.
SALLE 2
18.
A gauche en entrant le coin de Ben : il met l’art en boîte lui aussi mais avec une exubérance qui en ferait presque un dissident s’il n’avait été considéré comme le relais « conventionné » de Fluxus en France par Maciunas. Ses valises ne sont pas sans rappeler les valises de Duchamp, elles participent du même principe : un rêve d’art total sans doute, que l’on pourrait circonscrire, dominer, mais qui, d’être ainsi dominé, est ridiculisé : toute l’histoire de l’art pourrait être réduite à un petit bagage !
19.
Henry Flynt. (deuxième salle, mur de gauche) N’est pas vraiment un artiste, c’est un mathématicien passionné de logique. Radical, il a beaucoup inspiré le manifeste de Maciunas. Il prônait la mort de l’art, il voulait brûler les musées et tout ce qui représentait à ses yeux la culture « sérieuse ». Ils ont manifesté Maciunas et lui pour la fermeture du MOMA. Il détruisit d’abord ses propres œuvres !
20.
Piano de La Monte Young. La Monte Young fut très marqué par Cage. Il voulait étendre le domaine du sonore à sa limite : il a fait voler un papillon sur scène en guise de pièce musicale (un papillon fait du bruit en volant, tout ce que nous voyons émet un son !). La Monte Young a passé son enfance dans une ferme de l’Idaho, il raconte qu’il entendait la nuit le vent passer entre les planches de la cabane où il dormait. Ici c’est un piano auquel il faut donner du foin et de l’eau, et la pièce ne finit qu’une fois que le piano a tout avalé. La Monte Young voulait ainsi créer la pièce la plus longue de Fluxus. Et en effet c’est une pièce qui n’a jamais fini ! Il est à noter que les œuvres des artistes Fluxus peuvent être refaites par d’autres, ici le piano est signé La Monte Young mais il a été exécuté par Ben. Cela rejoint les principes de Filliou pré-cités.
21.
Dick Higgins : (4 tableaux mur de gauche) tirer avec une carabine sur une partition créé des notes aléatoire que l’artiste doit « exécuter » ! Les artistes Fluxus ont souvent manipulé la musique et ses instruments jusqu’au martyre… Higgins a créé les éditions « Something else press », car Maciunas mettait trop de temps et trop peu de moyens dans les siennes. Ce fut vécu par Maciunas comme une véritable trahison. Higgins a publié beaucoup d’artistes jusqu’en 1974 (Claes Oldenburg entre autres).
22.
« Fesses » photo extraites du fluxus-film de Yoko Ono. Avant d’être la femme de qui vous savez, elle fut une des premières à participer à des happenings avec son premier mari compositeur. Elle a filmé ici des fesses qui marchent. Ce film, interdit aux mois de 18 ans et presque abstrait, est visible sur u-tube http://fr.youtube.com/ (Cherchez « fluxfilm »). Maciunas a réalisé des Fluxfilms, qui en général ne durent que quelques minutes, avec de nombreux artistes. Il y en a de Brecht, Watts, Yoko Ono, Vostell, Paik…
23. George Brecht 1964 « Polir un violon » (photos mur face). C’est un grand classique de Fluxus, la pièce se joue en astiquant aussi soigneusement que possible un violon.
24.
George Brecht « Drip music » : verser de l’eau dans des récipients, ne serait-ce pas là une symphonie moderne ?
25. Nam June Paik : créateur de robots. Il a été « excommunié » par Maciunas car il a connu le succès et fut exposé seul dans des galeries et des musées. (même chose pour Yoko Ono). Or Fluxus est d’abord un art collectif. L’ironie veut qu’on ne connaisse Fluxus que par ceux qui se sont fait un nom ! C’est le cas de Paik, de Beuys ou de Ben.
26.
Images de Brecht et Higgins à la New School of Social Research avec John Cage : première rencontre de membres de Fluxus.
27.
Tomas Schmit (mur de droite, bouteilles de lait). Il était assez jeune au début du mouvement. Il a créé cette pièce « Zyklus », le cycle , qui rejoint l’une des grandes obsessions des membres de Fluxus : l’origine, la création permanente. Il est à noter que de nombreuses œuvres du mouvement portent ce même titre. Un jour le jeune Thomas n’avais pas assez d’argent pour se payer l’avion et rejoindre le groupe pour un concert, il demanda à Maciunas de l’aider qui refusa sous prétexte qu’il n’avait qu’à gagner de l’argent. Selon Maciunas un artiste devait travailler et être « utile » à la société !
28.
Robert Watts travaillait dans l’édition comme Maciunas, il a aussi joué avec les images.
29.
Un grand classique de Nam June Paik : bouddha et télé, dénonçant la prédominance de l’image sur le monde, cette nouvelle religion devant laquelle un bouddha même vient se recueillir. La télé n’étant pour Paik qu’une grande caisse vide. Le coréen Nam June Paik était évidemment sensible à l’écart entre tradition et modernité…
30.
Alison Knowles était la femme de Higgins. Graphiste elle aussi, elle a beaucoup travaillé sur les impressions, les textiles et développé une œuvre très personnelle.
31.
Le piano à clous de Maciunas, intitulé « Carpenter piece », pièce pour Charpentier, (cloué et peint lors d’une performance) est accompagné d’un event de George Brecht qui consiste à apporter un vase et à le poser sur un piano.
lus solidaires. L’Institut, les Athéniens le savent bien, a traversé avec bravoure les tumultes de l’Histoire et fut pour beaucoup d’intellectuels, d’artistes et d’étudiants, un refuge dans les heures pénibles. Voilà pourquoi nous avons souhaité associer à cette célébration, Fluxus, mouvement issu des contestations des années 60, transgressif, souvent révolutionnaire, résistant, à sa manière, contre toutes les formes d’oppression.
Le mouvement Fluxus, comme le révèle sa racine latine flux, circula comme un torrent en faisant grand bruit au passage des obstacles. En Europe comme en Amérique, et dès les années 70 en Grèce, il suscita de vivifiants mélanges entre les arts : musique, théâtre, arts plastiques, littérature, architecture… faisant sauter les clivages, renonçant aux étiquetages rapides et arbitraires, revendiquant la liberté dans l’union : vaste programme qui devait trouver de nombreux émules en Grèce ! Citons les musiciens Grigoris Semitokolos et Giannis Christou qui donnèrent une impulsion nouvelle au dialogue entre les arts, à leur démocratisation et enfin à l’implication du public au travers de happenings et d’installations plastiques. Peintres, poètes, scientifiques, compositeurs se retrouvèrent également autour de Yannis Xenakis et de Stephanos Vasiliadis dans le cadre du Centre de Création de Musique Contemporaine créé en 1985.
On assiste aujourd’hui encore à une véritable résurgence de Fluxus : art video, art cinétique, art optico-cinétique, art numérique, Net.art, mail art ont tous puisé leur source auprès de ces merveilleux « ancêtres » des années 60. Dans cette évolution Fluxus a joué en effet un rôle déterminant. Dick Higgins, un artiste et écrivain du mouvement, amena le terme d’ « intermedia » pour parler de pratiques artistiques se situant entre les supports traditionnels. Explorant en effet les interstices entre l’art et la vie, Fluxus s’est installé entre musique et art, entre théâtre et vie, entre artisanat et industrie, entre objet unique et multiple : il y a des timbres Fluxus, des tampons, des dés, des vêtements, il y a eu une messe Fluxus, une coopérative, des projets pour l’établissement d’une île Fluxus (dans les Cyclades peut-être ?)… De Fluxus, mouvement international, parlant toutes les langues, sont issus Nam June Paik, inventeur de l’art vidéo, Robert Filliou, créateur de la « République géniale », du principe d’équivalence entre « Bien fait, mal fait et pas fait », Joseph Beuys déclarant « tout homme est un artiste », Ben enfin, investissant sans relâche tous les supports en quête d’apports artistiques inédits.
Remettant radicalement en cause l’art, Fluxus l’a par là même radicalement renouvelé, livrant toujours son combat avec humour et un très grand sens de la dérision. L’art contemporain est une fête, Fluxus le prouve à chaque fois. Des années 70 à nos jours le flux de ce mouvement provocateur à traversé tous les arts et inspiré la France comme la Grèce, revendiquant le droit à la « gratuité » dans un monde dominé par les échanges économiques. Préférant de loin troquer des devises contre des aphorismes, ces artistes avant-gardistes, sont de lumineux apôtres d’une église sans chapelle, d’un mouvement sans maître.
L’Institut Français d’Athènes a donc choisi l’art contemporain pour fêter ses 100 ans au Musée Bénaki. Car, au-delà des commémorations nécessaires il appartient d’inscrire l’histoire prestigieuse de l’Institut dans de grandes manifestations artistiques portées par des artistes d’aujourd’hui. « Rendre l’art accessible à tous en le rapprochant » n’est pas seulement la formule sacrée de ce mouvement populaire et généreux, c’est aussi un principe que nous adoptons volontiers dans notre travail au quotidien, à l’Institut, et que nous faisons nôtre ici tout particulièrement.
Caroline Fourgeaud-Laville
VISITE DES SALLES
SALLE 1
1. Manifeste Fluxus de Maciunas : écrit en 1966, texte fondamental du mouvement exposant tout ce qui différencie Fluxus du « grand » art. le problème de Fluxus c’est que ce n’est pas un mouvement constitué. Personne n’a jamais signé de manifeste. Celui-ci a été signé par Maciunas et n’engage que lui. Fluxus n’existe pas en 58, il ne naît vraiment qu’à partir de 62 avec la série de concerts Fluxus qui voient le jour en Allemagne, et se poursuivent en Europe. Avant cela Maciunas qui vivait à New York, rencontra Yoko Ono et La Monte Young qui l’initièrent au monde de l’avant-garde ; comme il possédait une galerie, la galerie « AG », il offrit à La Monte Young la possibilité d’organiser des soirées où l’on pouvait assister à de la musique-action, de la musique électronique, du cinéma, de la poésie… Ces soirées faisaient suite à celles que Yoko Ono avaient organisées dans son propre atelier peu auparavant. Ces soirées faisaient une large place à l’avant-garde artistique, ouvertes à toutes les expressions, de la musique vers l’action, la poésie, de la poésie vers la musique, vers le théâtre, etc. Le hasard, la participation éventuelle du public, l’improvisation, l’environnement quotidien (gestes, objets…) jouaient aussi leur rôle, et l’idée même d’abolition des frontières artistiques était très importante… Lorsqu’un éditeur californien proposa à La Monte Young de préparer un numéro spécial sur le bouillonnement artistique des années 60, celui-ci s’acquitta de sa tâche ; mais le projet fut abandonné, Maciunas reprit alors le matériel pour réaliser une anthologie Fluxus avant l’heure, intitulée tout simplement « An Anthology », brochure qui marque le début de l’engagement de Maciunas dans ce qui allait devenir « Fluxus ». Après 61, Maciunas étant criblé de dettes (les derniers concerts Fluxus organisés chez lui se font sans électricité), il décide de quitter les Etats-Unis pour l’Allemagne, où Nam June Paik se propose de le recevoir. Maciunas y travaillera comme graphiste d’un journal de l’armée américaine. Il rencontre beaucoup d’artistes : Nam June Paik, Ben Patterson, Vostell, Stockhausen qui organisent des cours et des conférences. Stockhausen est un homme rigoureux et difficile alors que Cage est très ouvert, « zen », il inspirera davantage les membres de Fluxus. C’est ici que commencent les concerts de Wiesbaden. Maciunas obtient en effet une salle du musée de Wiesbaden pour jouer pendant un mois tous les week-end des concerts Fluxus. Puis ces concerts s’exportèrent à Paris, Londres, Amsterdam, Copenhague, Düsseldorf, enfin à Nice où Ben accueillera le Festival Fluxus en 1963. Lors de ces concerts, il y avait des pièces de tous les artistes, de nature très différentes. Il y en avait de très longues qui pouvaient durer des heures, et de très courtes, moins d’une minute. Or Maciunas a principalement souhaité valoriser les pièces courtes de quelques minutes, plus accessibles au public, en les orientant vers plus de drôlerie et de comique. C’est une vision qui peut paraître, aux yeux de certains, quelque peu réductrice de l’esprit Fluxus, mais c’est elle qui aujourd’hui encore est défendue par Ben, elle est aussi la plus populaire. Ben préfère le court et le drôle parce qu’il en connaît très bien les vertus pédagogiques.. En 1964 le groupe a éclaté. Maciunas voulait tout diriger d’une main de fer, rêvant de piloter un collectif d’artistes, il proposa que chaque artiste abandonne sa signature, son copyright, pour venir s’abriter derrière le seul sigle de Fluxus. Or très vite les personnalités les plus fortes et les plus abouties ont préféré voler de leurs propres ailes : Nam Jun Paik, Dick Higgins sont les premiers à trahir cet idéologie. Maciunas était en effet très marqué par Henry Flynt, mathématicien, philosophe et artiste Fluxus, mobilisé par la pensée communiste et qui voulait l’appliquer à l’art. Sous son influence, Maciunas voulait donner un tournant révolutionnaire à Fluxus, provoquer des manifestations violentes, et monter des concerts Fluxus en URSS, le long du transsibérien. Il va même jusqu’à écrire Khroutchev en ce sens. C’est à ce moment-là que les artistes ont commencé à s’éloigner. Maciunas a réagi en publiant, d’une manière obsessionnelle, des listes arborescentes d’adhérents sans demander par ailleurs leur avis aux artistes cités ! Certains se trouvaient alors inscrits dans Fluxus, ce fut le cas de Ligeti, ou se retrouvaient exclus sans en être informés. Maciunas ajoutait ou retranchait des noms compulsivement dans le simple but de s’ériger comme leader d’un immense groupe aux membres toujours plus prestigieux ! En 1963 Maciunas revient à New York et décide d’asseoir Fluxus en créant une structure sur Canal Street : le Fluxus Hall et le Fluxus Shop. Il fait jouer Dick Higgins, Alison Knowles, Emmett Williams et George Brecht. Ben vient passer un mois à New York car les deux hommes avaient sympathisé : c’est d’ailleurs curieux, parce qu’il ne faut pas oublier que l’ego était proscrit par l’idéologue Maciunas, un ego dont Ben a fait sa marque. cela prouve combien Fluxus a toujours été pétri de contradictions. En 1964 Yoko Ono rentre au Japon, Paik s’y installe aussi. Higgins quitte aussi le groupe. La Monte Young poursuit son chemin vers la musique minimale. Malgré l’éclatement du mouvement, l’on peut donner un bilan positif de ces quelques années fondatrices car beaucoup de pratiques de l’art contemporain ont été inventées par ces artistes : art vidéo, art conceptuel, body art, livre d’artiste, boîte d’artiste… Fluxus a mis sa patte dans la plupart des nouvelles pratiques de l’art contemporain. Même l’art relationnel dont on parle aujourd’hui (prendre le thé ensemble), procède des idées Fluxus. Après 1964 Fluxus a surtout existé à travers la production de petites boîtes éditées par les artistes, par la création d’objets, plus que par la musique. Maciunas aimait le concret. La production d’objets Fluxus utilisait des produits industriels (boîtes en plastique…), mais elle était le plus souvent totalement artisanale. C’est Maciunas aidé quelquefois d’autres artistes qui fabriquait tout à la main. Fluxus s’est poursuivi au moins jusqu’à la mort de Maciunas en 1978. C’est ainsi que Maciunas a contribué à la naissance du quartier des artistes qu’est SoHo, qui était jusqu’alors un quartier de petite industrie, en permettant à de nombreux artistes d’y installer des ateliers, et il ne fut jamais en manque de grandes idées pour Fluxus : il organisa une messe Fluxus, un mariage Fluxus (le sien), projeta de créer des communautés d’artistes, une dans une ferme à la campagne, une sur une île qu’il voulait acquérir au cœur de l’archipel des îles Vierges britanniques.
2.
Eric Andersen « Performance area, do not enter » : l’impossible performance ! Musicien et compositeur, c’est en 1962 qu’il adhère à Fluxus lors du concert de Copenhague. Andersen explore avec humour ces espaces de liberté qui nous sont toujours refusés. C’est aussi sans doute la preuve que pour Fluxus un geste minimal confinant au non geste, à l’absence de manifestation est encore une performance : il peut ne rien se produire dans la zone de performance, son accès peut vous être refusé, c’est encore une performance. Ne pas entrer sacralise le lieu de cette action qui n’existe pas. Cela rejoint Cage et sa musique de silence
3.
Robin Page. Comme souvent, pas mal de personnes n’ont fait que passer dans le mouvement le temps d’un concert. C’est le cas de Robin Page qui a participé au concert de 1962 à Londres, au Festival of Misfits, où il s’était illustré en cassant une guitare. Il s’agit ici du reste sans doute d’une de ses performances érigée en œuvre d’art. Son titre de gloire est d’avoir cassé une guitare sur scène avant Jimmy Hendrix.
4.
Robert Filliou et son principe d’équivalence “bien fait, mal fait, pas fait”. Son oeuvre s’inscrit quant à elle délibérément dans le “mal fait” d’où l’utilisation du scotch. Il interroge l’origine de l’art par la génétique, l’archéologie, les planètes, en montrant que l’art se rattache à la création du monde. Il donna un jour une série de papiers déchirés dans un musée allemand pour une expo et il retrouva ses papiers reconstitués par les restaurateurs du musée : c’est l’œuvre qui est affichée ici. Il dénonce la sacralisation de l’art qui pousse les spécialistes à recueillir le moindre fragment d’une œuvre passée et à considérer, par excessive métonymie, qu’elle puisse être exposée comme un tout. Pour Filliou la poussière recueillie sur un tableau de Leonard n’est pas un Leonard ! Il faut en finir avec cette fétichisation extrême de l’œuvre et du nom qui lui est attaché.
5.
Giuseppe Chiari. La plupart des artistes Fluxus sont au départ musiciens, c’est le cas de Chiari. Beaucoup de Fluxus se sont retrouvés en Allemagne à une époque, au Festival de Darmstadt dans les années 50, où de nombreux musiciens d’avant-garde jouaient des pièces : Stockhausen, Cage… Dans un mouvement d’inversion les musiciens Fluxus prouvaient que tout pouvait faire musique en détournant notamment les instruments, en pervertissant les codes sacrés du concert classique. Ligeti lui-même avait créé une pièce pour métronomes : ce qui n’est qu’une utilité mais qui dirige autoritairement le rythme du jeu, un métronome, devient tout à coup la pièce exécutante, comme si le musicien avait repris le contrôle du concert, repris le pouvoir sur la règle castratrice. Beaucoup d’artistes Fluxus ont créé des slogans, celui de Chiari est “Art is easy”.
6.
Serge III (frère de Zoé Oldenbourg). Russe de Nice. Artiste radical. Il a joué à la roulette russe sur scène avec un vrai pistolet chargé. Lors d’un voyage à Prague avec Ben, ils ont voulu faire passer quelqu’un de l’autre côté de la frontière sans passeport. Serge III s’est fait arrêté et a dû faire un peu plus d’un an de prison en Tchécoslovaquie (66-67). Il s’est toujours vraiment engagé. Après sa sortie de prison il s’est mis à travailler sur les affiches de pubs ou de cinéma, en en détournant les codes.
7.
Wolf Vostell. Graphiste au départ. Il est à la limite de Fluxus. Il a commencé par décoller des affiches comme les artistes du Nouveau Réalisme, mais il a très vite étendu le principe de décollage au happening, en considérant que le corps lui-même en action était dans une action de décollage extrême, par la violence et la destruction. Il s’emploie à dévoiler la violence latente d’une société apparemment lisse. En 1960, à Paris, il avait lu dans les journaux qu’un avion s’était abîmé en mer après son décollage. Pour lui c’est le moment où la réalité dépasse la fiction, le moment où la violence surgit dans la réalité sans qu’on s’y attende. Les membres du groupes lui reprochaient son manque de modestie qui, doctrinairement, devrait l’éloigner de Fluxus. Maciunas, le pape de Fluxus, s’opposait à lui fréquemment sur ce point. Vostell était très dynamique, très inventif, il avait créé sa propre revue “décollage”, or Maciunas était moins habile que lui ! Vostell a participé aux concerts des années 62 et 63, et créé un musée Fluxus en Espagne, à Malpartida. En tant qu’Allemand son œuvre montre à quel point il est hanté par le passé nazi et la violence.
8.
Joseph Beuys. D’une certaine manière il est encore plus « limite » que Vostell. Il s’est imposé alors que son œuvre n’a pas grand chose à voir avec le groupe. Il est très expressionniste, il s’est créé sa propre mythologie, celle d’un aviateur allemand dont l’avion se serait écrasé pendant la seconde guerre mondiale en pleine Asie Centrale. Il prétend à partir de là avoir été secouru par des chamans et ramené par eux à la vie. Fourrure, graisse, sont ses matières fétiches, de même que l’énergie est son principal sujet : chaleur, feu…
9.
Ben Patterson. Au départ c’est un vrai musicien, un concertiste qui a joué dans de prestigieux orchestres, un virtuose de la contrebasse. Il vit aux Etats-Unis et il lui est interdit, parce qu’il est noir, de jouer dans des orchestres symphoniques. Il quitte donc les Etats-Unis pour s’installer au Canada où il deviendra concertiste pour le philharmonique d’Ottawa. Puis il part en Allemagne où il entre à l’orchestre de la 7ème armée américaine. Il souhaite très vite rencontrer Stockhausen à Cologne. La rencontre est décevante. Cage au contraire le bouleverse et il décide alors de composer lui-même des pièces. Il restera un certain temps en Allemagne. Il publie un ouvrage de ses compositions aujourd’hui introuvable (dont « paper piece » qui fut interprétée le soir du vernissage). En 1962 Il part à Paris et rencontre Filliou qui lui mettra une œuvre dans son chapeau ! Il a voulu faire une œuvre basée sur l’action avec une participation du public. Selon lui il faut hisser la musique jusqu’à la vie. La dimension comique de ses interprétations n’empêche pas l’ambition de son projet. Il a fait ainsi de « l’action » jusqu’en 63 puis il est rentré aux Etats-Unis. A l’époque la révolte des Blacks Panthers battait son plein, il a donc choisi de s’engager politiquement jusqu’en 80 où il recommence une pratique libre et personnelle de l’art et de la musique, en intégrant des revendications. Interrogations : peut-on parler de « culture noble » et de « culture pas noble », de grande ou de petite culture ?
10.
George Brecht. (table et boîte avec vignettes) Il est l’un des membres les plus importants du groupe, plus que Maciunas qui ne fut au fond qu’un « organisateur », un meneur. Il est chimiste au départ, et a même produit des brevets, a travaillé dans des laboratoires pharmaceutiques. Il s’est intéressé au hasard dans l’art en étudiant l’aléatoire chez Jackson Pollock, puis il a rencontré Cage et a suivi ses cours. Aux côtés de Cage il a approfondi la notion de hasard en art en la reliant à la physique des particules : le hasard est au cœur de la matière et tout s’organise autour de son incidence. Un jour il est rentré chez lui et s’est aperçu que le clignotant de sa voiture marchait tout seul, il a trouvé ça très beau et ce fut ce qu’il a baptisé ensuite « event ». il a donc composé de petites cartes avec des events à réaliser, même mentalement . Un event peut être infiniment simple : placer deux chaises face à face ; ou plus complexe : vous allez en voiture chez le garagiste, vous faites gonfler votre pneu jusqu’à ce qu’il éclate puis vous rentrez chez vous. En un mot, il s’agit vraiment d’appliquer les idées sans engager son ego. Avec Robert Filliou ce sont les plus stimulants du groupes, ce sont de véritables concepteurs. Brecht a mis ses « events » en boîtes : les « boîtes magiques de Brecht ». La réduction d’une idée ou d’une œuvre à une boîte, ou à une petite carte, est un classique du groupe qui pratique l’art du minimalisme avec une certaine science. Le rôle des petits objets dans l’expression du mouvement est capital. En 1962 il avait créé son Festival à New York « Yam » au mois de mai (anagramme). Il est le vrai cerveau du groupe et le détenteur incontesté de l’esprit Fluxus : anonymat , faire en sorte qu’un objet banal soit transformé en œuvre puis revienne dans le domaine de la vie sans qu’on puisse après coup déterminer son statut.
11.
Filliou. (vitrine centre) Il appartient à une lignée d’artistes qui, de Marcel Duchamp à Joseph Beuys et de Kurt Schwitters à John Cage, remet en cause les relations traditionnelles de l’art et du monde : « C’en est fini pour moi des objets-œuvres d’art. Ils ne sont plus pour moi que des pistes de décollage. » L’œuvre de Robert Filliou reste, de part en part, obsédée par l’idée de paix. En 1970, il réalise Commemor, proposant « aux pays qui songeraient à faire la guerre d’échanger leurs monuments aux morts avant et au lieu de se la faire ».Dans cette perspective, il a fondé « The Afro-Asiatic Combine » (dédié à la recherche sur l’influence de la pensée contemporaine africaine et asiatique sur la culture occidentale), la Biennale d’art de la paix à Hambourg et il a imaginé l’année des « 365 premiers avril » (1971). Au travers de ses images, mots, objets, actions, installations et autres « briquolages », Filliou envisage l’œuvre comme une langue universelle dont l’utopie consiste à abolir les frontières entre l’art et la vie. « L’art, remarque le créateur de la « République Géniale », est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. ». Il a participé à Fluxus pour la première fois en 1962, à Paris, avec Maciunas. Dans l’une des vitrines on voit un chapeau découpé : c’est une galerie d’art dans un chapeau ! Il jetait des photos d’œuvres d’art de tous ses amis dans le chapeau, de sorte qu’il devienne un « couvre chefs-d’œuvre ». A l’instar de ce qui est exposé ici, de nombreuse œuvres de Fluxus sont créées puis répétées à un petit nombre d’exemplaires, car les membres de Fluxus jouent sur la notion de reproductibilité de l’œuvre sans aucun complexe.
12.
Serge III. Il a fait des verres en négatifs (vitrine) mais aussi des armoires en négatif : il coulait du ciment dans une armoire puis il détruisait l’armoire pour libérer la forme pleine.
13.
Charles Dreyfus, joue sur les mots. Ses œuvres portent, gravées à l’or fin sur des objets utilitaires très communs, des formules à clefs, à déchiffrer comme des énigmes en forme de calembours. Il est le premier Français à avoir fait un travail universitaire sur Fluxus puis il a, en 1974, organisé une petite exposition au Musée d’art Moderne de la ville de Paris. Enfin il est allé à New York où il a rencontré Maciunas et les autres artistes Fluxus. Depuis il mène la double activité de critique et d’artiste.
14. Maciunas (mur de droite en entrant) Il peut être considéré comme le pape du mouvement. Il était graphiste. Il avait instauré la règle du 8-8-8 car il exigeait une discipline de chacun des membres du groupe : dans une journée on devait travailler 8 heures, dormir 8 heures et le reste du temps devait être consacré à une activité Fluxus. En tant que graphiste il a édité des journaux Fluxus qui ne se sont jamais vendus, il les composait en faisant des montages de documents qu’il trouvait à la bibliothèque de New York et qu’il détournait. Il a ouvert un magasin fluxus (Fluxus shop) et une salle de spectacle Fluxus, mais les affaires ont toujours très mal tourné. Il s’est mis à utiliser les œuvres des autres et à les réduire en boîte : La Monte Young avait inventé une pièce qui consistait à faire du feu en public. Maciunas a mis des allumettes dans une de ses boîtes en plastique et a collé dessus l’étiquette suivante : « pièce de La Monte Young » qu’il vendait dans son magasin de Canal Street à New York (c’est un exemple de la fameuse circulation des œuvres dans le groupe).
15.
Ben signe tout et c’est ainsi qu’il se réapproprie le monde, en le phagocytant…
16.
Horloge de Charles Dreyfus : le temps s’affole !
17.
Portrait de John Cage (mur de droite avant d’entrer dans la deuxième salle) On peut dire que Fluxus a commencé en Allemagne à la fin des années 50, autour de Darmstadt, puis le mouvement a émigré aux Etats-Unis en 60, la création du quartier de Soho n’en est que la plus vive expression. On peut également dire que l’acte de naissance du mouvement est largement entre les mains de John Cage et sur ses partitions alors même qu’il se tiendra toujours à l’écart du groupe, Maciunas assumant seul la tâche de dictateur. Cage disait que ce qu’il préférait dans un concert c’était le moment où les musiciens accordaient leurs instruments car alors le public n’était qu’attentif aux sons pas aux geste où à la mise en scène du concert.
SALLE 2
18.
A gauche en entrant le coin de Ben : il met l’art en boîte lui aussi mais avec une exubérance qui en ferait presque un dissident s’il n’avait été considéré comme le relais « conventionné » de Fluxus en France par Maciunas. Ses valises ne sont pas sans rappeler les valises de Duchamp, elles participent du même principe : un rêve d’art total sans doute, que l’on pourrait circonscrire, dominer, mais qui, d’être ainsi dominé, est ridiculisé : toute l’histoire de l’art pourrait être réduite à un petit bagage !
19.
Henry Flynt. (deuxième salle, mur de gauche) N’est pas vraiment un artiste, c’est un mathématicien passionné de logique. Radical, il a beaucoup inspiré le manifeste de Maciunas. Il prônait la mort de l’art, il voulait brûler les musées et tout ce qui représentait à ses yeux la culture « sérieuse ». Ils ont manifesté Maciunas et lui pour la fermeture du MOMA. Il détruisit d’abord ses propres œuvres !
20.
Piano de La Monte Young. La Monte Young fut très marqué par Cage. Il voulait étendre le domaine du sonore à sa limite : il a fait voler un papillon sur scène en guise de pièce musicale (un papillon fait du bruit en volant, tout ce que nous voyons émet un son !). La Monte Young a passé son enfance dans une ferme de l’Idaho, il raconte qu’il entendait la nuit le vent passer entre les planches de la cabane où il dormait. Ici c’est un piano auquel il faut donner du foin et de l’eau, et la pièce ne finit qu’une fois que le piano a tout avalé. La Monte Young voulait ainsi créer la pièce la plus longue de Fluxus. Et en effet c’est une pièce qui n’a jamais fini ! Il est à noter que les œuvres des artistes Fluxus peuvent être refaites par d’autres, ici le piano est signé La Monte Young mais il a été exécuté par Ben. Cela rejoint les principes de Filliou pré-cités.
21.
Dick Higgins : (4 tableaux mur de gauche) tirer avec une carabine sur une partition créé des notes aléatoire que l’artiste doit « exécuter » ! Les artistes Fluxus ont souvent manipulé la musique et ses instruments jusqu’au martyre… Higgins a créé les éditions « Something else press », car Maciunas mettait trop de temps et trop peu de moyens dans les siennes. Ce fut vécu par Maciunas comme une véritable trahison. Higgins a publié beaucoup d’artistes jusqu’en 1974 (Claes Oldenburg entre autres).
22.
« Fesses » photo extraites du fluxus-film de Yoko Ono. Avant d’être la femme de qui vous savez, elle fut une des premières à participer à des happenings avec son premier mari compositeur. Elle a filmé ici des fesses qui marchent. Ce film, interdit aux mois de 18 ans et presque abstrait, est visible sur u-tube http://fr.youtube.com/ (Cherchez « fluxfilm »). Maciunas a réalisé des Fluxfilms, qui en général ne durent que quelques minutes, avec de nombreux artistes. Il y en a de Brecht, Watts, Yoko Ono, Vostell, Paik…
23. George Brecht 1964 « Polir un violon » (photos mur face). C’est un grand classique de Fluxus, la pièce se joue en astiquant aussi soigneusement que possible un violon.
24.
George Brecht « Drip music » : verser de l’eau dans des récipients, ne serait-ce pas là une symphonie moderne ?
25. Nam June Paik : créateur de robots. Il a été « excommunié » par Maciunas car il a connu le succès et fut exposé seul dans des galeries et des musées. (même chose pour Yoko Ono). Or Fluxus est d’abord un art collectif. L’ironie veut qu’on ne connaisse Fluxus que par ceux qui se sont fait un nom ! C’est le cas de Paik, de Beuys ou de Ben.
26.
Images de Brecht et Higgins à la New School of Social Research avec John Cage : première rencontre de membres de Fluxus.
27.
Tomas Schmit (mur de droite, bouteilles de lait). Il était assez jeune au début du mouvement. Il a créé cette pièce « Zyklus », le cycle , qui rejoint l’une des grandes obsessions des membres de Fluxus : l’origine, la création permanente. Il est à noter que de nombreuses œuvres du mouvement portent ce même titre. Un jour le jeune Thomas n’avais pas assez d’argent pour se payer l’avion et rejoindre le groupe pour un concert, il demanda à Maciunas de l’aider qui refusa sous prétexte qu’il n’avait qu’à gagner de l’argent. Selon Maciunas un artiste devait travailler et être « utile » à la société !
28.
Robert Watts travaillait dans l’édition comme Maciunas, il a aussi joué avec les images.
29.
Un grand classique de Nam June Paik : bouddha et télé, dénonçant la prédominance de l’image sur le monde, cette nouvelle religion devant laquelle un bouddha même vient se recueillir. La télé n’étant pour


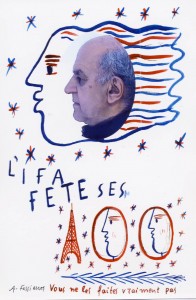
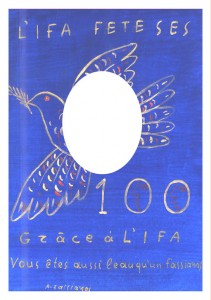


 René Taïeb
René Taïeb jésuites. Je suis le produit d’une grande salade méditerranéenne. Le Liban était un pays où le caractère hétérogène laissait un espace de liberté pour les minorités. Les pays arabes ont un art de la vie dont on garde toujours la nostalgie, y compris en Israël. D’ailleurs c’est une des raisons pour lesquelles je vis aujourd’hui à Bastille, c’est le cœur et le recueil de plusieurs quartiers, ça rappelle plus Beyrouth que le Marais ! Je suis arrivé en France en 75 à cause de la guerre, et ce fut un immense bonheur, je me disais : Sartre ouvre sa fenêtre en même temps que toi, Malraux est vivant ! C’est d’ailleurs par Blanchot que je me suis réintéressé au judaïsme : avant ça me paraissait de vieilles choses fossilisées bonnes pour mes parents ! Moi j’ai appris l’hébreu sans que jamais aucun professeur ne pense à me dire que ça avait un sens et que je n’étais pas en train de prononcer des paroles de vaudou africain ou des formules cabalistiques ! C’est Blanchot qui, après-guerre, a pris la défense du judaïsme. C’était sa façon à lui de « réparer » par un travail de réflexion sur les auteurs juifs comme Jabès et Lévinas. J’ai commencé à voir que la pensée juive pouvait être vivante et forte. C’est cette génération qui a ramené la pensée juive dans la pensée générale.
jésuites. Je suis le produit d’une grande salade méditerranéenne. Le Liban était un pays où le caractère hétérogène laissait un espace de liberté pour les minorités. Les pays arabes ont un art de la vie dont on garde toujours la nostalgie, y compris en Israël. D’ailleurs c’est une des raisons pour lesquelles je vis aujourd’hui à Bastille, c’est le cœur et le recueil de plusieurs quartiers, ça rappelle plus Beyrouth que le Marais ! Je suis arrivé en France en 75 à cause de la guerre, et ce fut un immense bonheur, je me disais : Sartre ouvre sa fenêtre en même temps que toi, Malraux est vivant ! C’est d’ailleurs par Blanchot que je me suis réintéressé au judaïsme : avant ça me paraissait de vieilles choses fossilisées bonnes pour mes parents ! Moi j’ai appris l’hébreu sans que jamais aucun professeur ne pense à me dire que ça avait un sens et que je n’étais pas en train de prononcer des paroles de vaudou africain ou des formules cabalistiques ! C’est Blanchot qui, après-guerre, a pris la défense du judaïsme. C’était sa façon à lui de « réparer » par un travail de réflexion sur les auteurs juifs comme Jabès et Lévinas. J’ai commencé à voir que la pensée juive pouvait être vivante et forte. C’est cette génération qui a ramené la pensée juive dans la pensée générale.

 réinventant le buon fresco ! Considérer les parois de son habitat comme un cahier ouvert est à l’origine de tout l’art de peindre et ce geste, depuis une vingtaine d’années, est redevenu l’un des gestes spontanés de l’homme avide de s’exprimer d’une manière immédiate, explosive et anonyme. Où que l’on aille dans le monde, des signatures d’hommes de passage, nocturnes et masqués, honorent en les déshonorant du même coup, les lieux les plus inattendus, les plus reculés, les plus inaccessibles de nos mobiliers urbains. Les villes d’occident, au grand désespoir des autorités municipales, sont outrageusement décorées de tags, sceaux de la modernité aux alphabets aussi indéchiffrables que chargés de mystère. Nos villes portent ainsi la marque au fer rouge du criminel jadis dénoncé par sa lettre écarlate. Est-ce vraiment le signe d’une condamnation ? Celle d’une civilisation honnie et rejetée, visée d’infamie ? Ne faut-il pas plutôt y voir le coup de griffe aimant, certes mordant, d’un jeu de mains avec l’autorité ?Tous les savants les plus raffinés, les amateurs de belle architecture et d’œuvres classiques jettent un œil dédaigneux, voire dégoûté, sur ces témoignages d’une irruption insolite, hirsute, inavouable, dans des rues qui, selon eux, devraient n’être qu’ordre et beauté … De New York à Paris, jusqu’à Plaka et Exarchia où les murs sont couverts de personnages aux visages étonnamment enflés, désireux semble-t-il de s’envoler pour échapper aux lois trop ordinaires de la vie, le tag magique et malfaiteur aura, qu’on le veuille ou non, « droit de cité » au sens propre du terme. On peut tenter d’éliminer ces lichens dont on ne sait pas jusqu’à quel point ils peuvent se révéler vénéneux, on peut encore tenter inexorablement de les effacer : la forme resurgit, l’inscription renaît d’elle même comme, littéralement, un « fait de société ». Des experts ont analysé le phénomène, des livres lui sont régulièrement consacrés, les critiques d’art ouvrent dorénavant leur réflexion à ce genre nouveau d’écriture automatique et de surréalité urbaine ouverte à tous. Des musées même s’y intéressent et libèrent leurs espaces à ces « gobelins des faubourgs, tissés sur la basse-lisse des trottoirs », comme aurait dit Raymond Hains. Il y a plus : la peinture reconnue comme telle s’inspire parfois de ces graffiti à l’insolent pouvoir de communication, et il arrive que des franchissements de frontière aient lieu entre les vigoureux « barbouilleurs nocturnes » et les peintres des galeries avant-gardistes. L’anonymat scandaleux est soudain sous le feu des projecteurs. Ainsi, du fait de la vitesse du monde qui met en liaison les plus anciens archaïsmes avec les inventions de l’avenir, l’Institut Français d’Athènes, admet désormais, non sans malice, que le grand mur qui le protège devienne la paroi ancestrale de notre plus ancien imaginaire, autorisant une fois encore la main de l’homme à peindre la fresque, et à y déposer avec une rapidité prodigieuse, à même le ciment frais, les signes, couleurs, lignes et formes d’une création plastique et picturale condamnée à la réussite parce que « irrécupérable » ! Les deux graffeurs qui ont taggé ce mur « à fresque » semblent avoir réappris les gestes premiers sur les premières matières. Ainsi, pour son centenaire, le vénérable bâtiment se trouve à la fois confirmé dans sa vocation à sauvegarder tout ce qui vient de l’antiquité des hommes tout en se retrouvant, antiquité ou pas, fort joyeusement rajeuni !
réinventant le buon fresco ! Considérer les parois de son habitat comme un cahier ouvert est à l’origine de tout l’art de peindre et ce geste, depuis une vingtaine d’années, est redevenu l’un des gestes spontanés de l’homme avide de s’exprimer d’une manière immédiate, explosive et anonyme. Où que l’on aille dans le monde, des signatures d’hommes de passage, nocturnes et masqués, honorent en les déshonorant du même coup, les lieux les plus inattendus, les plus reculés, les plus inaccessibles de nos mobiliers urbains. Les villes d’occident, au grand désespoir des autorités municipales, sont outrageusement décorées de tags, sceaux de la modernité aux alphabets aussi indéchiffrables que chargés de mystère. Nos villes portent ainsi la marque au fer rouge du criminel jadis dénoncé par sa lettre écarlate. Est-ce vraiment le signe d’une condamnation ? Celle d’une civilisation honnie et rejetée, visée d’infamie ? Ne faut-il pas plutôt y voir le coup de griffe aimant, certes mordant, d’un jeu de mains avec l’autorité ?Tous les savants les plus raffinés, les amateurs de belle architecture et d’œuvres classiques jettent un œil dédaigneux, voire dégoûté, sur ces témoignages d’une irruption insolite, hirsute, inavouable, dans des rues qui, selon eux, devraient n’être qu’ordre et beauté … De New York à Paris, jusqu’à Plaka et Exarchia où les murs sont couverts de personnages aux visages étonnamment enflés, désireux semble-t-il de s’envoler pour échapper aux lois trop ordinaires de la vie, le tag magique et malfaiteur aura, qu’on le veuille ou non, « droit de cité » au sens propre du terme. On peut tenter d’éliminer ces lichens dont on ne sait pas jusqu’à quel point ils peuvent se révéler vénéneux, on peut encore tenter inexorablement de les effacer : la forme resurgit, l’inscription renaît d’elle même comme, littéralement, un « fait de société ». Des experts ont analysé le phénomène, des livres lui sont régulièrement consacrés, les critiques d’art ouvrent dorénavant leur réflexion à ce genre nouveau d’écriture automatique et de surréalité urbaine ouverte à tous. Des musées même s’y intéressent et libèrent leurs espaces à ces « gobelins des faubourgs, tissés sur la basse-lisse des trottoirs », comme aurait dit Raymond Hains. Il y a plus : la peinture reconnue comme telle s’inspire parfois de ces graffiti à l’insolent pouvoir de communication, et il arrive que des franchissements de frontière aient lieu entre les vigoureux « barbouilleurs nocturnes » et les peintres des galeries avant-gardistes. L’anonymat scandaleux est soudain sous le feu des projecteurs. Ainsi, du fait de la vitesse du monde qui met en liaison les plus anciens archaïsmes avec les inventions de l’avenir, l’Institut Français d’Athènes, admet désormais, non sans malice, que le grand mur qui le protège devienne la paroi ancestrale de notre plus ancien imaginaire, autorisant une fois encore la main de l’homme à peindre la fresque, et à y déposer avec une rapidité prodigieuse, à même le ciment frais, les signes, couleurs, lignes et formes d’une création plastique et picturale condamnée à la réussite parce que « irrécupérable » ! Les deux graffeurs qui ont taggé ce mur « à fresque » semblent avoir réappris les gestes premiers sur les premières matières. Ainsi, pour son centenaire, le vénérable bâtiment se trouve à la fois confirmé dans sa vocation à sauvegarder tout ce qui vient de l’antiquité des hommes tout en se retrouvant, antiquité ou pas, fort joyeusement rajeuni !


 De retour au sud, à Arcueil, laissez la demeure seigneuriale de Jean Raspail sur votre droite pour entrer directement dans le jardin. Le portail s’ouvre tout seul. Alors, vous avancez jusqu’au palmier qui, de son panache cendré, triomphe seul dans la cour et vous cède le passage jusqu’au chalet peuplé de masques colombiens. Vous tentez de vous frayer un chemin entre les sculptures et les tableaux quand un rire bienveillant tonne au loin : c’est
De retour au sud, à Arcueil, laissez la demeure seigneuriale de Jean Raspail sur votre droite pour entrer directement dans le jardin. Le portail s’ouvre tout seul. Alors, vous avancez jusqu’au palmier qui, de son panache cendré, triomphe seul dans la cour et vous cède le passage jusqu’au chalet peuplé de masques colombiens. Vous tentez de vous frayer un chemin entre les sculptures et les tableaux quand un rire bienveillant tonne au loin : c’est  Non loin de là
Non loin de là  Fin d’après-midi, Métro Gallieni. Le ciel est noir éclairant d’une flamme acide les tags du périphérique.
Fin d’après-midi, Métro Gallieni. Le ciel est noir éclairant d’une flamme acide les tags du périphérique.  Cap sur la Place d’Italie. Il fait très beau, c’est le 1er mai, des brins de muguet à la boutonnière, nous annonçons notre arrivée. La pièce n’est pas très grande mais fonctionnelle. Une affiche est placardée sur la porte que nous venons de refermer : une exposition collective dans les années 60, tout le monde est présent, les figuratifs, les abstraits, sans distinction ! On aperçoit tout de suite une table encombrée d’objets et de lettres, sortes de fétiches, témoins de ses plus belles rencontres : Beckett, Bram Van Velde, un cuivre immaculé reçu des mains de Morandi…
Cap sur la Place d’Italie. Il fait très beau, c’est le 1er mai, des brins de muguet à la boutonnière, nous annonçons notre arrivée. La pièce n’est pas très grande mais fonctionnelle. Une affiche est placardée sur la porte que nous venons de refermer : une exposition collective dans les années 60, tout le monde est présent, les figuratifs, les abstraits, sans distinction ! On aperçoit tout de suite une table encombrée d’objets et de lettres, sortes de fétiches, témoins de ses plus belles rencontres : Beckett, Bram Van Velde, un cuivre immaculé reçu des mains de Morandi…  Plus au nord loge
Plus au nord loge  Direction Porte d’Orléans. Un bus nous trimballe un mardi chez
Direction Porte d’Orléans. Un bus nous trimballe un mardi chez  Où peut bien se cacher l’atelier de
Où peut bien se cacher l’atelier de